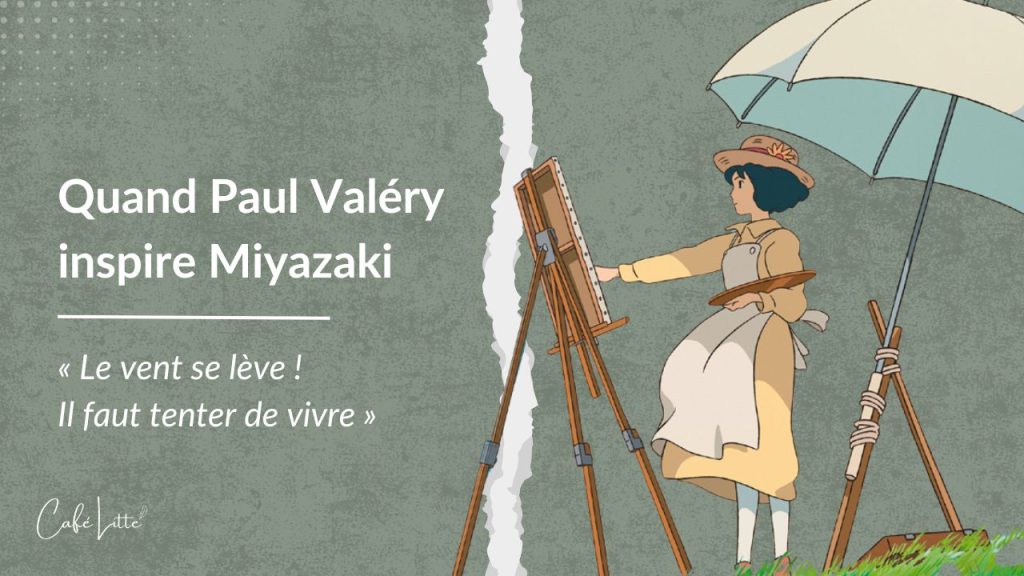Le vent se lève de Hayao Miyazaki a déjà été vu, commenté, disséqué. On a parlé de sa dimension historique, de la figure romancée de l’ingénieur Jirō Horikoshi, de la question morale de l’art face à la guerre. Mais à CaféLitté, nous avons voulu rouvrir le film par une autre porte : celle de la littérature.
Sous la surface narrative, il existe un tissage intertextuel rare : un vers de Paul Valéry devenu devise philosophique, un roman japonais de Tatsuo Hori qui en hérite, et un film d’animation qui transforme tout cela en poème visuel. Revisiter Le vent se lève par cet angle, c’est découvrir que Miyazaki n’est pas seulement un cinéaste : il est aussi, par le geste, un poète.
Un Titre Venu de la Poésie Française
Le titre reprend un vers du Cimetière marin (1920) de Paul Valéry : « Le vent se lève ! Il faut tenter de vivre ! ». Dans ce poème, le narrateur contemple la mer figée, avant qu’un souffle de vent n’agite l’air et rompt l’immobilité. Ce changement, presque imperceptible au début, devient un signal d’alarme : il faut se lever, agir, vivre.
Miyazaki ne l’emprunte pas directement à Valéry, mais via le roman Kaze Tachinu (1937) de Tatsuo Hori, où le vers devient un fil rouge dans l’histoire d’un homme aimant une femme condamnée par la tuberculose. Dans le livre, la phrase revient lors des promenades à la campagne ou au bord d’un lac, comme un rappel que le bonheur ne dure pas.
Le film reprend ce rôle de boussole philosophique : on entend la phrase lorsque Jirō et Naoko passent un après-midi à peindre en plein air, assis face à un paysage agité par le vent. La lumière baisse, les nuages s’amoncellent, et le vers devient presque un adieu déguisé.
La Prose Poétique de l’Image
Miyazaki compose ses plans comme un poème. Il utilise l’ellipse et le silence pour dire ce que les mots ne peuvent pas formuler. Par exemple, lorsque Jirō rêve pour la première fois de Caproni, le décor passe d’une plaine japonaise à une vallée italienne sans transition, comme si on changeait de strophe.
Les ellipses sont nombreuses : après une conversation intense, un simple plan sur l’herbe ployée par le vent prend la place d’un dialogue conclusif. On retrouve cette logique dans la scène où Naoko disparaît de l’écran pour laisser place à un plan fixe sur les montagnes enneigées — une manière de dire qu’elle s’éloigne sans que l’on voie sa marche.
La nature traduit l’état d’âme : les séquences oniriques, notamment les dialogues entre Jirō et l’ingénieur italien Caproni, sont construites comme des paraboles littéraires. Caproni incarne le mentor romanesque : il parle en images, enseigne par métaphores, guide le héros non pas vers la vérité, mais vers une manière de vivre avec ses contradictions. Chaque plan fonctionne comme un vers isolé, que l’on pourrait presque extraire et lire. La lumière diffuse, les transitions fluides, la lenteur assumée : tout cela forme un texte invisible qui court derrière l’image.

© 2013 Studio Ghibli
Un Récit Elégiaque
L’amour entre Jirō et Naoko n’a rien du mélodrame : c’est une élégie, un chant sur la beauté condamnée. La maladie de Naoko n’est jamais mise en scène avec pathos ; elle se devine dans un geste (une toux retenue, un souffle court en gravissant une pente).
L’évaporation des instants heureux est frappante. Leur promenade dans les collines se termine sans au revoir : la scène coupe sur un plan large, et on devine que ce moment ne reviendra pas. Cette disparition soudaine de la joie rappelle les romans de Kawabata, où le temps emporte les personnages comme un courant invisible.
Il y a aussi quelque chose de proustien dans la façon dont Miyazaki retient les détails sensoriels : le bruit du pinceau sur la toile, l’ombre des nuages sur la plaine. Ces instants, isolés, deviennent des madeleines visuelles, des fragments que le spectateur garde en mémoire alors que l’histoire les a déjà laissés derrière.

© 2013 Studio Ghibli
Le Rôle Discret mais Essentiel de la Littérature
La littérature traverse le film de manière organique :
- Les lettres que Jirō et Naoko s’envoient rythment la progression de leur histoire. Elles agissent comme des chapitres intimes.
- Les conversations sont construites comme des dialogues écrits : phrases brèves, images métaphoriques, silences qui font sens.
- La poésie s’infiltre jusque dans la manière de filmer : lors du dernier échange entre les deux personnages, le vent couvre une partie des mots — comme un vers effacé qu’il faut deviner.
Ainsi, Le vent se lève ne cite pas seulement Valéry : il adopte une logique littéraire, celle qui laisse des blancs pour que le lecteur — ou ici le spectateur — y glisse sa propre lecture.

© 2013 Studio Ghibli
Revisité à travers le prisme de la littérature, Le vent se lève apparaît comme un poème visuel autant qu’un récit historique. Il est à la croisée de trois voix : celle de Valéry, méditant sur le vent qui rompt l’immobilité ; celle de Tatsuo Hori, racontant un amour contre la montre ; et celle de Miyazaki, qui transforme ces héritages en une fresque d’images.
Dans le poème comme dans le film, le vent n’est pas un simple phénomène naturel : c’est le signal que tout peut basculer. Et c’est là que réside l’héritage littéraire du film : l’invitation à tenter de vivre, malgré la fragilité du monde et l’inévitabilité de la perte.