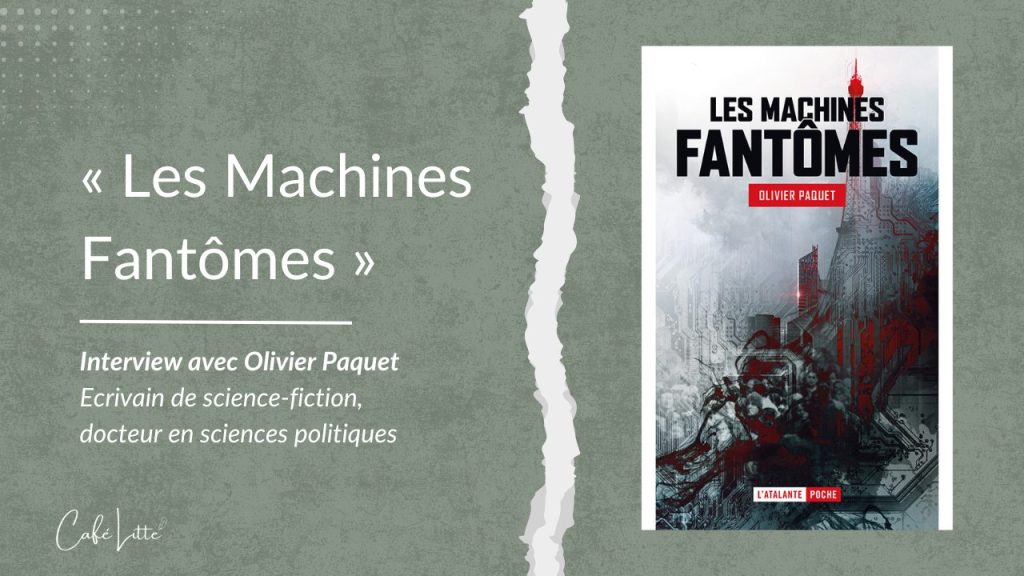Dans son roman Les Machines fantômes, Olivier Paquet refuse le schéma simpliste d’un affrontement homme/machine. L’écrivain de science-fiction explore l’IA comme un prisme, un révélateur de nos identités, de nos fictions et de nos contradictions. Loin des dystopies tonitruantes, il interroge avec acuité la manière dont ces technologies, déjà présentes dans notre quotidien, transforment notre rapport au réel et mettent à l’épreuve notre humanité.
– Plutôt que de présenter l’IA comme une menace ou une aide bienveillante, vous l’explorez dans Les Machines fantômes comme un révélateur de la condition humaine, un miroir qui dévoile des vérités cachées sur nos vies. Pourquoi avoir choisi cette approche plutôt qu’un affrontement classique homme/machine ?
O.P. Dès mon tout premier texte, je m’étais déjà intéressé à la question, notamment au rapport entre intelligence artificielle et art. Dans mon premier texte publié, La première œuvre (1998), on pouvait déjà voir, si l’on y prêtait attention, l’invention du prompt. Pour moi, en tant qu’écrivain de science-fiction, l’objet technique ou technologique n’est jamais une finalité : il constitue un moyen d’interroger l’humain. L’intelligence artificielle, dès lors qu’elle cherche à imiter l’homme, conduit à s’interroger : qu’est-ce qui, en nous, relève du mécanique et peut être reproduit par une machine ? Cette interrogation ouvre un champ de réflexion presque philosophique. Ma démarche consiste précisément à interroger l’humain à travers le prisme de l’intelligence artificielle. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas l’objet technologique en soi, mais l’homme. La science-fiction, au fond, ne parle que de cela : de l’humain, observé à travers un prisme, comme sous une loupe qui permet de le regarder autrement.
– L’univers des Machines fantômes reste très proche du nôtre, sans exagération futuriste. Selon vous, vivons-nous déjà dans une société façonnée par l’IA, peut-être sans en avoir conscience ?
O.P. Dans Les Machines fantômes, j’imagine un univers situé en 2035 : une projection très proche, presque une « science-fiction dans dix minutes », comme me disait un ami. J’ai voulu montrer à quel point les algorithmes, les machines, les intelligences artificielles sont déjà liés à notre intimité. Le téléphone, le smartphone, tout ce qui circule sur Internet créent un rapport très personnel avec la machine. Certaines études montrent même que des personnes disent parfois « merci » à un distributeur de billets. Ce rapport devient troublant : nous avons avec ces machines une relation qui, bien que mécanique, touche à notre quotidien le plus intime. C’est ce que je voulais explorer : observer que les machines que j’invente dans le roman se rapprochent de la place que tiennent nos animaux domestiques. Elles modifient notre rapport au monde en s’inscrivant dans une forme de proximité affective.

Olivier Paquet, écrivain et docteur en sciences politiques / ©Lensman Michael Meniane
– Vos personnages sont confrontés à des forces qui les dépassent : système financier, illusion médiatique, guerre invisible. Peut-on dire que votre roman est une métaphore de ces mécanismes qui conditionnent nos vies ?
O.P. Oui. Ce qui est intéressant, lorsqu’on se penche sur la question du système financier, c’est de constater que, d’une certaine manière, ce sont déjà des intelligences artificielles qui s’affrontent entre elles et qui orientent le cours des choses. C’est donc une réalité actuelle. Ces intelligences artificielles sont présentes partout dans le monde, elles manipulent une quantité considérable de nos données, et elles nous dépassent par leur capacité à accomplir des opérations d’une ampleur bien supérieure à ce que nous pouvons réaliser à notre échelle.
– Beaucoup de vos personnages – je dirais même tous – sont en quête de leur propre vérité, coincés entre ce qu’ils sont réellement et ce que la société projette sur eux. Diriez-vous que l’IA, dans Les Machines fantômes, agit comme un révélateur de leur identité plutôt que comme un simple outil technologique ?
O.P. Oui. Dans Les Machines fantômes, je traite en réalité de la question des fictions, des fictions que nous nous construisons. L’identité renvoie à cela. J’avais déjà exploré cette problématique lors de mes recherches en sciences politiques, notamment dans ma thèse consacrée à l’identité des minorités nationales. On y retrouvait déjà cette idée de fiction : fiction d’État, fiction collective, fiction individuelle. Chaque individu, chaque personnage élabore sa propre fiction, et les intelligences artificielles viennent percuter ces constructions. Elles obligent à recomposer, à inventer de nouveaux récits pour tenir compte du réel. Ces machines nous contraignent à reposer des questions fondamentales sur la réalité, à réajuster le réel en fonction des fictions que nous avons bâties. Car ces fictions, au fond, sont déjà une manière d’appliquer une mécanique au monde, même si cette mécanique émane de nous. Nous sommes en permanence pris entre la recherche d’authenticité et la nécessité de nous inventer des fictions qui, elles aussi, portent une part d’artificialité.
– À travers vos personnages, vous montrez également des existences qui se déshumanisent. L’IA accélère-t-elle cette perte d’authenticité ou, au contraire, pousse-t-elle à se redéfinir ?
O.P. J’aimerais qu’elle nous pousse à nous redéfinir. Le problème, c’est que les intelligences artificielles sont des outils, mais la question essentielle est : entre quelles mains se trouvent-ils ? On le voit avec ChatGPT ou d’autres systèmes : aujourd’hui, ce sont de grandes entreprises, et parfois des individus comme Elon Musk, qui les utilisent avant tout pour servir leurs propres intérêts. Dans ces conditions, la dimension d’émancipation que pourraient porter les IA reste extrêmement limitée, car elles sont soumises à des forces économiques et politiques très puissantes. La véritable question n’est donc pas l’intelligence artificielle en elle-même, mais l’usage qu’on en fait et les objectifs poursuivis. Or, la science-fiction permet d’explorer un contraste fécond : imaginer en quoi une machine pourrait devenir un outil de libération, tout en montrant que, dans la réalité, ce n’est pas le cas.
– La science-fiction a souvent anticipé les grandes révolutions technologiques. Pensez-vous que la littérature, dans ce contexte, a un rôle à jouer dans notre façon d’appréhender l’IA aujourd’hui ?
O.P. C’est en effet un défi pour les écrivains de science-fiction : traiter le sujet afin d’explorer les possibles. Le propre d’un texte de science-fiction est précisément d’imaginer des possibles et d’en observer les conséquences. Ensuite, c’est au lecteur de réagir, de s’approprier ces pistes et d’en faire quelque chose. J’estime que mon rôle est d’offrir au lecteur un ensemble de questionnements, de lui dire : voilà les interrogations que l’on peut avoir, à toi maintenant de chercher les réponses. Je ne prétends pas apporter de solution quant à l’avenir, car je n’en ai pas. Ce que j’écris aujourd’hui pourra très bien perdre de sa pertinence dans un an ou deux. En revanche, les questionnements, eux, demeurent, et c’est à chacun d’y trouver ses propres réponses.
– En tant qu’écrivain de science-fiction, adoptez-vous une posture optimiste ou inquiétante sur l’avenir de l’intelligence artificielle ?
O.P. En tant que citoyen, je peux avoir une opinion, notamment sur le fait que ces technologies restent opaques : on n’a pas accès aux sources, les systèmes sont contrôlés par des acteurs comme Elon Musk ou de grandes entreprises, et cela soulève de nombreuses interrogations complexes. Mais en tant qu’écrivain, je cherche avant tout à laisser la place au lecteur. C’est à lui, en fonction de ce qu’il lit, de réagir : soit en imaginant un avenir plus actif, plus prometteur, soit en adoptant une position de vigilance. Mon rôle est d’ouvrir le champ des possibles, non de proposer un point de vue unique et univoque. J’aime d’ailleurs constater que mes romans suscitent des lectures contrastées : certains y voient une mise en garde contre les dangers de l’IA, d’autres y perçoivent une perspective plus ouverte, une autre manière d’envisager la relation à ces technologies. Le fait que le texte puisse être interprété de plusieurs façons me semble être une richesse.
L’entretien complet avec Olivier Paquet est à écouter ci-dessous.